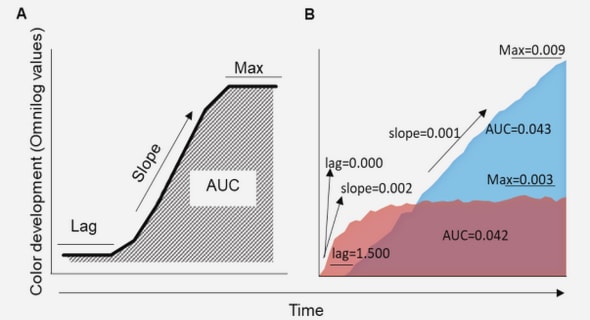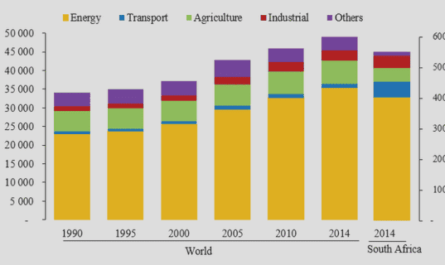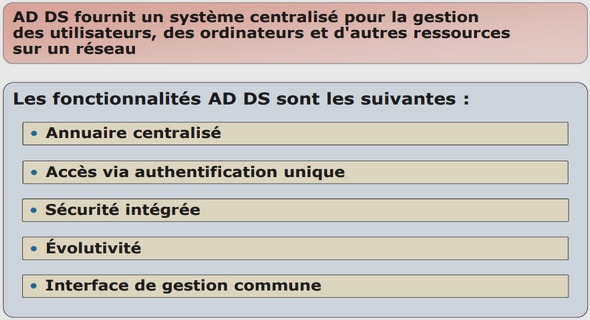Get Complete Project Material File(s) Now! »
MIROIR, MIROIR …
La Statue de set (1953)
Ce premier roman, publie en 1953, s’elabore deja depuis 1950, en France, avant Ie retour d’ Albert Memmi en Tunisie en 1951. Cette precision est importante : elle atteste que l’auteur tunisien ecrit ce premier livre, qu’on pourrait qualifier de texte-phare, puisqu’il eclairera toute l’oeuvre a venir, dans une situation d’exil ala fois physique et psychologique. Ce qui signifie que Ie monde evoque dans Ie texte porte toute la nostalgie d’un monde perdu, mais dont Ie souvenir continue a hanter Ie present morcele et aliene du narrateur loin de son pays natal. Ce dernier se trouve donc autobiographiquement en exil, et autographiquement Ie texte pionge ses racines dans I’ experience de la perte et de la fragmentation interieure.
Les nombreux entretiens accordes par Albert Memmi confirment la nature autobiographique de La Statue de set: « C’est un livre plus autobiographique qu’une veritable autobiographie, je I’ai ecrit autant pour composer une oeuvre litteraire que pour mettre de l’ordre dans mon existence a un moment donne » (1970). « Plus autobiographique qu’une veritable autobiographie », I’ecrivain ne veut-il pas en fait dire plus autographique qu’une veritable autobiographie qui donnerait a lire plutot une suite chronologique et evenementielle de la vie de l’auteur ? Le « plus » evoque ici contient toute la dimension d’autographie car I’ecrivain, comme nous Ie verrons, ne fait pas que relater sa vie, mais l’interprete afin (comme ille dit lui-meme) d’y « mettre de l’ordre », ou meme de lui donner forme. Si bien qu’en faisant Ie recit des evenements de son enfance et de son adolescence, dans ce premier roman, Ie narrateur spatialement et temporellement exile raconte tantot en focalisant sur Ie narrateur- personnage (personnage qu’il etait) au moment des evenements relates et tantot en focalisant Ie recit a travers sa conscience en tant que narrateur au moment de la narration.
Dans cette seconde focalisation, il intervient dans Ie recit et dit sa perspective d’ adulte par rapport a I’ enfant qu’il etait, menant ainsi a une reinterpretation du passe sous un autre angle dont la portee depasse la simple autobiographie puisqu’elle entrainera la reconstruction d’un etre humain, c’est-a-dire un projet d’autographie. C’est alors que nous pouvons poser la question hermeneutique suivante : y aura-t-il une veritable reconstruction par l’ ecriture et quelle sera sa fonction dans l’oeuvre de fiction d’Albert Memmi ?
Nous nous pencherons donc assez longuement sur ce premier roman en avan9ant de maniere heuristique a travers Ie texte, afin d’y decouvrir les preoccupations fondamentales de l’ecrivain reveIees a la fois par l’autobiographie et l’autographie. La probIematique, devoilee lentement et progressivement dans ce texte d’autofiction, servira de base a l’analyse de tous les ouvrages qui suivront.
La Statue de set s’ ouvre sur un texte-preface intitule HL ‘Epreuve ». II s’ agit d’une epreuve d’examen pas see par Ie narrateur adulte. Pourquoi Ie roman prend-il naissance durant un examen ? Un examen, c’est, sur Ie plan autographique, se me surer aux autres, etre accepte par les autres qui en ont fixe les regles; si on repond bien, c’ est montrer qu’ on est capable et donc etre reconnu, accepte. Mais cette obligation de repondre a l’examen empeche que cette reconnaissance par les autres soit inconditionnelle.Pour qui a soif de se savoir accepte tel qu’il est, cette epreuve se transforme en revolte contre ce qui est etabli par les Autres par rapport auxquels il se sent terriblement etranger; illes refuse et s’aliene d’eux. Epreuve donc il y a, mais comme symbole d’une epreuve existentielle, celle de « l’examen » de sa propre vie afin de decouvrir et d’affirmer qui on est veritablement. C’est ainsi que Ie narrateur ecrira cinquante pages pendant l’ examen. Elles constitueront une premiere redaction du roman qui s’ouvre sur des preoccupations fondamentales de l’ecrivain, sinon la plus fondamentale, celle de son rapport aux Autres, qui sera presente et persistante dans toute son oeuvre a venir. Albert Memmi l’admet : « Finalement, Ie drame principal de ma vie a ete non l’argent (…) ni Ie succes (…) ni meme l’ecriture (…) mais ma relation avec autrui » (1985 : 221).
Des les premieres pages, Ie mot negatif »plus », lourd d’irrevocabilite dans ‘je ne sais pas, je ne sais plus », « ne me concement plus », nous indique que Ie narrateur n’est plus a sa place, qu’il se trouve en situation d’exil dans cette salle d’examen, ne pouvant plus etablir de rapport ni avec ses voisins, un nord-africain et un fran9ais, ni avec Ie principe meme de I’examen: « Comment ai-je pu m’interesser a des jeux si etonnamment futiles ? » (1953 : 12).
Emerge egalement sa grande solitude par rapport « aux autres », ceux qui se penchent a l’unisson sur leur feuille d’examen, ceux qui « savent ce qu’ils veulent ». C’est au moment de la prise de conscience de cette alienation totale qu’intervient Ie processus de I’ecriture, non pas celle attendue par les autres, mais l’ecriture autobiographique dont il etablit lui-meme Ie pacte : « Cet oubli par l’ ecriture, qui seul me procure quelque calme, me distrait du monde, je ne sais plus m’entretenir que de moi-meme » (1953 : 13). Ce moi est defini aussitot comme dechire et fragmente : « Quelle naIvete d’ avoir espere surmonter Ie dechirement essentiel, la contradiction qui fait Ie fond de ma vie ! »(1953 : 13).
« J’ai ecrit sept heures durant (…) C’est que ma vie tout entiere me remontait a la gorge » (1953 : 13). Sa vie, ilIa vomit litteralement « de son coeur a sa plume » pour « fuir », dit-il, c’est-a-dire fuir sa condition presente d’aliene devenue intolerable. Dans ce texte introductif, imprime en italiques et demarque ainsi du reste du roman, s’exprime donc Ie ‘je » actuel du narrateur, nous l’appellerons Ie narrateur du present, parti a la recherche d’un moi revolu. Des la premiere lecture, Ie melange des temps (passe compose, present, futur) expose la conscience du sujet affole, qui craint l’avenir, renie Ie passe et ne peut s’installer dans Ie present. II constate : « Je vais gaspiller toute ma vie. Mais qu’en ai-je fait jusqu’ici ? Je ne peux plus soutenir ce role » (1953 : 13). La solution a ce mal-etre evoque sera l’ oubli par I’ecriture autobiographique porteuse, il est a esperer, d’un retour au calme suggere par Ie soudain passe simple de I’avant-demiere phrase du texte : « A la fin de l’epuisante seance, j’emportai une cinquantaine de pages » et aussi de la promesse d’un nouveau depart qu’indique Ie futur dans: « Peut-etre en ordonnant ce recit arriverai-je a mieux voir dans mes tenebres et decouvrirai-je quelque issue » (1953 : 14). L’idee de depart se realisera d’ailleurs concretement a la fin du roman quand Ie heros partira pour I’ Argentine, emportant sans doute avec lui ces cinquante pages ecrites pendant I’ epreuve.
Au texte de « L ‘Epreuve » succede la premiere partie du roman intitulee « L ‘Impasse » qui ouvre la narration annoncee dans « L ‘Epreuve « . Cette partie prend la forme classique d’un recit au passe simple, bien demarque du texte precedent par sa typographie romaine. Cette partie comprend huit recits autodiegetiques qui nous plongent dans Ie passe lointain du narrateur, celui de la petite enfance et de l’enfance.
Les deux premiers chapitres intitules respectivement« L ‘Impasse » et « Le Sabbat » sont une description du bonheur pur. Bonheur protege dans l’espaceetroit, Ii l’abri au fond de l’impasse « deux fois cachee ». L’enfant s’y sent en totale securite et en complete harmonie avec Ie monde qui l’entoure.Des passages lyriques evoquent les couleurs, sons, odeurs, nourritures et costumes traditionnels d’un monde lumineuxet simple oil les divinites protectrices se nomment « la mere, les voisins, Ie pere ».Ce sont eux qui, en cas de peril, apparaissent « tout-puissants »pour Ie sauver. La description de l’enfant et du pere dormant enlaces (« Je me serrais contre mon pere …, lui mettant les jambes sur Ie ventre. Lui posait sa grosse main sur ma tete » – 1953 : 17) suggere l’intimite bienheureuse de cet espace confine, cocon feutre et protecteur, « irreel et doux » precise Ie narrateur, rappel ant Ie statut ephemere du bonheur oil baigne tout Ie texte et la precarite du monde de I’ enfance oil Ie petit gar90n evolue avec la legeret6 (d’etre) « de la bulle caressee par Ie vent ». II y est « Ie fil de soie dans sa trame », la couleur dans l’arc-en-ciel, il y fait partie d’un tout bien ordonne, mais condamne Ii ne pas durer. En effet, la menace de deterioration semble accompagner ineluctablement l’avenir et s’incarne aussi dans l’image de la lune dont la presence bienfaisante eclaire la chambre commune des les premieres lignes du roman, repoussant Ie noir de la nuit au-del Ii de la fenetre. La lune est presente dans les dernieres pages du livre aussi, oil elle est devenue lune malefique, porteuse de folie, metamorphosee en esprit du mal.
Dans ces deux premiers chapitres, des signes avant-coureurs de malaise peuvent être detectes au sein de I’harmonie lumineuse qui y est pourtant décrite; la focalisation glisse du moment de la fiction Ii celui de la narration lorsque Ie narrateur intervient dans son espace temporel d’adulte pour exprimer la nostalgie de ce qu’il a perdu et Ie malheur qui accompagne cette perte : « Je perdisl’Impasse »(1953 : 21).L’ampleur de cette perte represente pour lui une veritable « catastrophe », « de si loinje souffre encore au souvenir du samedi matin » (souvenir parfait d’un bonheur perdu aujourd’hui). Cette nostalgie amere se prolonge dans Ie troisieme chapitre oil Ie narrateur declare des l’introduction : « J’etais innocent dans un monde que je croyais innocent » (1953 : 33). Le regret d’un monde perdu, qui affleurait dans les chapitres precedents, devient plus persistant : « II n’a pu durer si longtemps ce bonheur confortable d’une vie reglee par Ie respect confiant et les justes craintes » (1953 : 33), « Je ne souffrais pas encore de la misere extreme du ghetto » (1953 : 34). « Je garde Ie regret de la chaleur jamais retrouvee » (1953 : 34). Toute cette nostalgie, qui impregne Ie texte sur Ie plan de I’ autographie, prepare a la narration de la premiere rupture dans la vie harmonieuse de I’ enfant, celle de la prise de conscience de sa pauvrete.
Lorsqu’il s’apen;oit qu’il ne porte jamais de vetements neufs, qu’il porte ceux des autres, il en ressent une honte terrible; lui qui meprisait les pauvres, lui qui se voulait « Ie roi de l’Impasse », s’aperc;oit qu’il est l’un d’eux et qu’inexorablement Ie regard meprisant des autres qu’il sent desonnais pose sur lui est un echo dans son propre regard pose auparavant sur Ie petit Fraji. C’est en fait de son propre mepris refracte qu’il souffiira desonnais. C’est a ce moment-Ia que s’opere l’effet de metamorphose inevitable de la chrysalide jusque-Ia totalement a I’ abri dans son cocon. Le monde interieur de I’ enfant est fracture par la honte qu’il ressent; Ie vetement, reflet exterieur de son moi identitaire, Ie gene, il finit par ne plus Ie supporter, ce qui equivaut presque a ne plus se supporter lui-meme : « Depuis, lentement, m’a gagne cette gene vestimentaire, caracteristique du pauvre honteux. Je ne me sentais bien dans aucun costume » (1953 : 42).
Cette gene et ce refus meme, occasionnes ici par Ie vetement, vont tres vite s’ amplifier lorsque l’enfant quittera l’Impasse pour la premiere fois. Nous Ie verrons tout au long du roman, chaque changement d’espace sera l’occasion d’une rupture et nous constaterons que la structure spatiale centrifuge du texte ouvrira a I’ enfant I’ espace du malheur qui ira s’ elargissant.
Le premier changement d’espace, c’est l’ecole oil l’enfant entre Ii sept ans ne sachant parler que Ie patois tunisien et oil il se retrouve brutalement face au fran9ais : « J’ etais devant un gouffre… Ie maitre ne parlait que fran9ais, je ne parlais que patois. Comment pourrions-nous nous rencontrer ? » (1953 : 44,45). Encore une fois, une note d’affolement resonne dans Ie texte Ii l’idee d’etre evalue et rejet6, et de faire defaut Ii cause de sa difference.
Ce nouvel espace est donc vecu comme un veritable traumatisme, – une « rupture totale », dit Ie narrateur -, celle de la communication avec les autres, Ii jamais remise en question. La focalisation glisse alors de la fiction vers la narration quand Ie narrateur, entrainant Ie lecteur brusquement dans Ie futur, commente l’unite fondamentale perdue, oil Ie dedoublement interieur de soi a un repondant corporel, celui de l’eparpillement des membres qu’on essaye de recoller en vain. De cette constatation emerge un bilan de ces ruptures: « Toute ma vie, mes amities, mes acquisitions furent soumises Ii une constante readaptation de ce que j’ etais » (1953 : 44), soulignant ainsi l’existence d’un espace interieurbouleverse.
Parallelement Ii cette rupture concernant la communication, naissent chez I’ enfant des sentiments dont il ne souP90nnait meme pas I’ existence, la haine et I’ envie devant Ie comportement de certains ecoliers riches. Cette prise de conscience favorise Ie deploiement d’un espace interieur d’alienation oil surgit un etre que l’enfant ne reconnait pas et qui pourtant est bien lui. L’importance, dans Ie roman, de ce dedoublement interieur est mise en evidence par Ie titre du chapitre. En effet, I’ auteur, qui aurait pu choisir comme titre « L ‘Ecole », dont il s’agit d’ailleurs tout au long du texte, decide de Ie nommer « Les Deux Sous « , posant ainsi I’ argent comme Ie catalyseur de I’ apparition des sentiments alienants qui determinent l’exil interieur de l’enfant : « Jusqu’ici, je n’avais pas eu la revelation de la jalousie et de l’envie, ou plutot si j’enviais les beaux vetements de SaUl et son argent de poche, c’etait sans animosite, sans amertume veritable » (1953 : 53). L’argent aura aussi un role Ii jouer dans Ie choix de partir en colonie de vacances, occasionnant un changement d’espace radical. C’est l’enfant lui-meme qui choisit de partir pour deux raisons: d’abord parce qu’on y acquiert « les joues rouges » Ii l’egal de « l’enfant ideal », Ie jeune Fran9ais pris comme modele par les enfants indigenes mal nourris; ensuite parce que c’est gratuit et qu’on doit « prendre ce qui est gratuit », formule bien en usage dans la communaute pauvre d’ oil vient I’ enfant, et qu’il a pleinement enterim5e. Pourtant, Ie rapport a l’argent est toujours facteur de honte, une alienation que l’enfant porte en lui et qui Ie fait se retracter lorsqu’il doit admettre son indigence devant les autres dont Ie regard-juge lui est trop penible. Ce rapport a l’argent, facteur a la fois de honte, d’envie et de haine, continuera tout au long du roman, mais servira seulement de pretexte a la difficulte des rapports avec autrui.
Si Ie pere accepte I’ offre gratuite de partir en colonie de vacances, la mere, par contre, reproche aussitot a l’enfant son egoYsme; comment peut-il seulement oser penser quitter ses parents? A ce moment, il y a retour a l’ espace-temps du narrateur pour donner raison a cette mere primitive, « cette bedouine », qui l’a accuse d’egoYsme ‘jusqu’au dernier jour » et dont il avait honte. Le narrateur du present lui reconnalt alors sa superiorite de coeur qui a sudemeler l’essentiel de l’accessoire tout au long de sa vie. Elle voit juste en lui, c’est elle (qu’il a pourtant rejetee) qui detient la verite sur lui.
Nous pourrions voir ici, sur Ie plan autographique, Ie soup90n (recurrent) d’une certaine responsabilite personnelle du narrateur dans son propre malheur et la volonte de rehabiliter sa mere, de lui rendre une certaine interiorite de profondeur, de perspicacite et de sagesse.
La honte de ses parents, il en fait I’ experience pour la premiere fois au depart pour la colonie.Dans la foule « europeenne », ses parents lui paraissent « gauches et honteux d’eux- memes », genes par leur patois chuchote que l’enfant juge « vulgaire et deplace ». Ce regard impitoyable de l’enfant est l’occasion d’une autre rupture causant un autre dedoublement que Ie narrateur explique par Ie probleme spatial troublant dont il a refait par la suite l’experience : « Etre tout pres d’eux et pourtant irremediablement separe » (1953 : 59).
QU’est-il advenu de ses divinites ? Illes a perdues comme il perdra aussi l’immense fierte qu’il avait pour son pere, « Ie tout-puissant », lorsque celui-ci, desireux de ramener l’enfant a la maison, se heurte au refus net du sergent qui dirige la colonie, et revient triste et abattu, vaincu, donner la reponse a son fils. Devant la soumission du pere, Ie regard que I’ enfant pose alors sur lui se trouve irremediablement altere par la honte et I’humiliation.La figure du pere est des lors ajamais transformee, elle subira au cours des romans ulterieurs une lente degradation.